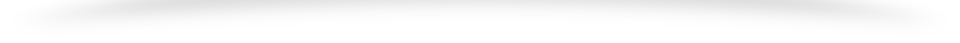JP Marthoz
Le Soir 07/12/2005
Le journalisme a toujours eu ses sténographes du pouvoir. Mais qui se souvient d’eux ? En France, la plupart sont très vite passés des lustres de la République aux oubliettes du métier. Paradoxalement, alors que le pouvoir s’agace des plumes rebelles et s’évertue à les disqualifier, l’histoire officielle finit presque toujours par les réhabiliter. Emile Zola ou Albert Londres ne se sont jamais mis au service de la raison d’Etat, mais c’est d’eux que s’enorgueillit, depuis des décennies, la « France reconnaissante ».
Quel maître le journaliste sert-il : les citoyens ou le pouvoir ? « Nous sommes là pour embêter le monde, répondait Horacio Verbitzky, l’un des plus célèbres journalistes argentins. Nous mettons du sel dans les blessures et des cailloux dans les chaussures. Nous cherchons le mauvais côté des choses car du bon côté, les attachés de presse s’en chargent. »
Que penser, dès lors, de journalistes qui prennent ostensiblement le parti du pouvoir ? Le livre très controversé de Pierre Péan sur le génocide de 1994 au Rwanda nous offre une occasion de réfléchir aux rapports complexes que la presse entretient avec des gouvernants qui sont, tour à tour, ses meilleures sources et ses meilleures cibles. S’il charge lourdement le Rwanda de Kagame, l’auteur semble tout aussi empressé de voler au secours d’un autre Etat, la France. Ponctué de dénonciations des « professionnels de l’anti-France », dénué de toute distance critique par rapport aux cercles officiels de la « Mitterrandie », son ouvrage débouche sur un étrange retournement du journalisme d’investigation : conçu par ses praticiens les plus éminents comme une couverture indépendante du pouvoir, il se transforme en défense et illustration d’un Etat. Et pas n’importe lequel : la thèse qu’il adopte d’une France généreuse, intelligente et irréprochable en Afrique centrale recouvre d’un voile de vertu l’histoire à tout le moins méandreuse de la Françafrique.
La proximité avec le pouvoir d’Etat serait-elle une fatalité du journalisme dont « l’élite, notait le politologue français Rémy Rieffel, s’identifie aux sujets qu’elle est censée surveiller » ? Illustrant cette thèse, les Etats-Unis ont eux aussi offert quelques exemples désolants de journalisme d’Etat. Ainsi, lors de la préparation de la guerre en Irak, en 2002 et 2003, Judith Miller a systématiquement relayé dans le New York Times les assertions non fondées des milieux néoconservateurs et d’exilés irakiens sur la présence d’armes de destruction massive en Irak. En polluant les puits de l’information, elle a contribué à promouvoir la guerre et a gravement entaché la réputation de son journal.
D’autres, à Fox News ou ailleurs, n’ont guère fait mieux, préférant la logique du pouvoir au pouvoir de la logique.
Toutefois, dans la culture journalistique américaine, subsiste une tradition qui veut que le « sens de l’Etat » implique souvent une mise en cause de la raison d’Etat. Un journaliste défend l’honneur de son pays non pas en vilipendant ceux qui critiquent les fautes des gouvernants, mais bien en soumettant ces derniers, comme le disait James Reston, du NY Times, « à un tir de barrage incessant ». La critique fait partie du système, elle est la condition même de son bon fonctionnement. Ainsi, en 1966, lors de la guerre du Vietnam, le président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, William Fulbright, avait fait l’éloge de ceux qui mettaient en doute le bien-fondé de l’intervention américaine. « Critiquer son pays, s’exclama-t-il, c’est lui rendre un service et lui faire un compliment. C’est lui rendre service parce que la critique peut pousser le pays à faire mieux ; c’est lui faire un compliment car c’est croire que le pays peut mieux faire. La critique est davantage qu’un droit, c’est un acte de patriotisme. »
Aux Etats-Unis, la critique de la politique étrangère est un genre journalistique à part entière et une voix royale vers le prix Pulitzer. Stephen Kinzer, auteur d’enquêtes sobres et fouillées sur le rôle de la CIA en Iran ou au Guatemala, fait partie du « système ». Samantha Power, qui publia une étude cinglante sur la passivité américaine face aux génocides du « siècle des génocides », a été recrutée par l’université de Harvard. Et Seymour Hersh, qui révéla le massacre de My Laï au Vietnam et qui enquête aujourd’hui sur les abus commis par les militaires américains en Irak, publie dans le New Yorker, l’un des magazines les plus prestigieux du pays.
En France, par contre, la mise en cause de l’Etat et surtout de sa politique étrangère semble rester une entreprise hasardeuse. Les journalistes qui osent contester la diplomatie gouvernementale risquent à tout moment d’être taxés de déloyauté. A l’instar des Mauriac, Bourdet, Vidal-Naquet ou Servan Schreiber qui, lors de la guerre d’Algérie, osèrent critiquer les brutalités de l’armée française et la « déraison d’Etat ».
Le « journalisme officiel » constitue, pourtant, un danger pour les intérêts fondamentaux d’une démocratie. La guerre en Irak a démontré tragiquement que le conformisme d’une grande partie de la presse américaine avait empêché que soient portées sur la place publique les objections émises non seulement par l’opposition, mais aussi par des institutions sommées de se taire, comme le Pentagone ou le département d’Etat.
En 1961, lorsque la CIA préparait l’invasion de Cuba par des exilés anticastristes, John Kennedy était intervenu auprès du New York Times pour empêcher (en vain) la publication d’une enquête de Tad Szulc sur cette opération « clandestine ». Après un échec cinglant sur les plages de la Baie des Cochons, le président admit que si la presse avait fait son devoir, c’est-à-dire si elle avait davantage informé, contraignant le gouvernement à testerses propres postulats, elle aurait épargné une défaite humiliante à l’Amérique.
« S’il y a une attitude franchement incompatible avec notre profession, s’exclamait Marcel Trillat de France 2 lors de la première guerre du Golfe, c’est le garde-à-vous. » C’est aussi l’attitude la plus incompatible avec l’esprit et l’intérêt d’un Etat démocratique.